Généalogiste et journaliste, auteur de best-sellers, Jean-Louis Beaucarnot a été surnommé le Pape de la Généalogie par le magazine l'Express.
Il témoigne de son utilisation de Filae et explique en quoi Filae a révolutionné la pratique de la généalogie.
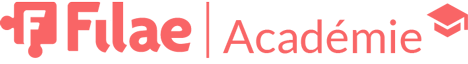
Filae.com vous propose la quasi-totalité de l’Etat-civil français du XIXème siècle depuis la Révolution française, numérisé, indexé et accessible par une simple recherche par nom de famille, soit l’accès immédiat à plus de 100 millions de pages d’état-civil contenant 200 millions d’actes.
L'Opendata au service de la généalogie
Ce projet a été rendu possible grâce aux travaux de numérisation des registres originaux principalement réalisés par les départements français. En vertu de la loi Valter « relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public » et de la loi Lemaire « pour une République Numérique », ces données officielles numérisées sont, depuis le 1er décembre 2016, librement réutilisables en Opendata par tout un chacun : citoyen, startup, associations…
C’est dans ce cadre et afin de rendre ces documents plus facilement accessibles par le grand public que Filae.com a pu apporter sa valeur ajoutée aux images brutes publiées en ligne par les départements. Ainsi, la transcription systématique des informations manuscrites contenues dans les actes (noms, prénoms, lieux, dates) a été intégralement financée et réalisée par Filae.com.
Quelles sont les données consultables
Les données ont été indexées dans le cadre d'autorisations CNIL qui définissent les périodes autorisées pour l'indexation :
- naissances : actes de plus de 120 ans révolus
- mariages : actes de plus de 104 ans révolus
- décès : actes de plus de 75 ans révolues
En vertu de ces autorisations, les mentions marginales sont également masquées de façon systématique sur tous les actes.
Comme vous pouvez l’imaginer, la numérisation et l’indexation de plus de 100 millions d’images peut générer quelques erreurs ou oublis. Les services d’archives départementales et les équipes de Filae ont tout mis en œuvre pour réduire au maximum ces désagréments. N’hésitez pas à nous les signaler, nous serons heureux d’y remédier dans les meilleurs délais.
Le projet dépend également de l’état d’avancement des projets de numérisations. Aussi, ne trouverez pas d’informations numérisées pour les départements du Gard, du Gers, du Jura et des Hautes-Pyrénées. Nous restons bien évidemment à la disposition de ces départements pour les aider dans leurs projets de numérisation et de publication des fonds d’Etat-civil.
Par ailleurs, certaines données concernant quelques villes françaises peuvent manquer car elles ne sont pas conservées aux Archives de leur département. Nous ne manquerons pas de vous prévenir lorsque ces données seront disponibles.
Nos collections généalogiques ne sont pas figées, elles sont mises à jour régulièrement !
N’hésitez pas à consulter fréquemment nos bases.
Explorer en quelques clics l’histoire de sa famille jusqu’à la Révolution Française est désormais possible
A cette occasion, Filae.com dévoile les résultats d’une étude OpinionWay* qui confirment l’intérêt des Français pour la recherche de leurs origines : 7 Français sont 10 sont intéressés par la généalogie, mais moins de 2 sur 10 aimeraient se découvrir un lien de parenté avec une personnalité politique !
Filae, une nouvelle génération de services rendue possible grâce à l’Opendata
Jusqu’à présent, retrouver qui étaient ses ancêtres, qui plus est jusqu’à la Révolution Française, tenait de l’exploit. C’est désormais possible très facilement sur www.filae.com.
Pour la première fois en France, Filae, PME française labellisée Entreprise innovante par Bpifrance, rend accessible et instantanément consultable les 250 millions d’actes originaux des naissances, mariages et décès de nos aïeux ayant vécu en France au XIXème siècle !
Ce nouveau service a été rendu possible grâce aux avancées récentes et décisives de l’Opendata en France, au travers de la loi relative à la gratuité et à la réutilisation des informations publiques (Loi « Valter ») et de la loi République numérique (Loi « Lemaire »). Filae a ainsi pu rassembler l’ensemble des archives publiques d’Etat-civil éparpillées sur tout le territoire, puis a déchiffré ces millions d’actes manuscrits et développé les technologies qui permettent d’interroger cette base gigantesque à partir d’un simple nom de famille.
Avec ce nouveau site, Filae.com apporte une interface très intuitive et une ergonomie moderne et ludique. Son ambition est de faire de la découverte de son histoire familiale un jeu d’enfants en permettant à chacun d’accéder simplement à tous les actes d’Etat-civil numérisés concernant ses ancêtres.
Pour le lancement de Filae, Stéphane Bern a accepté d’accompagner la présentation de ce nouveau service, et a ajouté: « Tel un arbre qui a besoin de ses racines pour grandir, un homme qui ne sait pas d’où il vient ne peut savoir où il va. »
A cette occasion, l’accès aux 250 millions d’actes numérisés sera gratuit jusqu’au 13 décembre : www.filae.com/recherche
Une étude d’OpinionWay* dévoilée aujourd’hui par Filae confirme que la généalogie est une activité qui revient à la mode
Les Français aiment la généalogie : plus des deux tiers sont intéressés par leurs origines…
Rechercher ses origines et ses racines, c’est tendance : en effet, 7 Français sur 10 (70 %) sont intéressés par la généalogie.
81 % des personnes interrogées estiment même que c’est une activité qui revient à la mode, notamment parmi les 50 ans et plus.
… et s’ils sont curieux de se découvrir un lien de parenté avec des figures historiques ou scientifiques, c’est moins le cas pour les politiques !
57% des Français aimeraient cousiner avec une personnalité, surtout avec :
- une personnalité historique (52%)
- une personnalité scientifique (45%).
- Ils ne sont que 20% à rêver de cousiner avec un people (acteur, chanteur ...).
… mais en cette période électorale, il est instructif de constater qu’ils sont moins d’un sur cinq (18 %) à avoir envie de découvrir qu’ils sont cousins avec une personnalité politique !
Par ailleurs, près de la moitié des Français (44 %) déclarent qu’ils aimeraient découvrir s’ils descendent de Charlemagne ou de Saint-Louis, sachant que 9 Français sur 10 descendraient de Charlemagne et 1 sur 10 de Saint-Louis.
…mais le fait d’entamer des recherches généalogiques semblait jusqu’ici compliqué pour 86 % des Français.
En effet, les Français méconnaissent les sources disponibles pour démarrer leurs recherches.
Bon nombre de Français sont découragés avant même d’entreprendre la moindre démarche : trop compliqué, trop coûteux, trop long (pour 98 % des personnes interrogées).
C’est ce paradoxe que Filae entend aujourd’hui résoudre.
Toussaint ROZE, Président de Filae, ajoute : « Tout le monde a une histoire. Filae voulait que tous puissent en faire l’expérience, simplement. C’est chose possible grâce au travail de regroupement et d’intégration de toutes les sources d’Etat-civil dans notre moteur de recherche patronymique et géographique. Désormais, tout un chacun peut explorer sa propre histoire familiale. »
Filae en bref
Filae.com est édité par la société FILAE SA. Créée par Toussaint Roze en 1994, cette PME française développe depuis des années une expertise unique dans la recherche et le développement de technologies innovantes pour faciliter l'accès du grand public à ses racines.
La société est basée à Paris et Laval et compte plus de 30 collaborateurs.
Grâce aux avancées législatives en matière d'Opendata et de réutilisation des archives publiques, la société a lancé, en décembre 2016, une nouvelle offre sur Internet qui succède à Genealogie.com : www.filae.com
*Une étude OpinionWay menée sur un échantillon de 1003 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, et a été redressé sur les critères suivants : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, catégorie d’agglomération et région de résidence. Les interviews ont été réalisées du 16 au 18 novembre 2016. Questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview).
Laissez-vous guider par Stéphane Bern pour bien démarrer sur Filae.com !
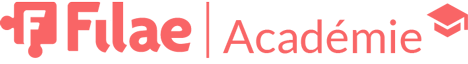
Nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau service ! Tout change mais l'essentiel demeure : les utilisateurs de Genealogie.com conservent leurs identifiants de connexion et peuvent accéder à leurs données dans la nouvelle interface.
Faire de la recherche un "jeu d'enfants"
Pourquoi un nouveau site ? Il nous fallait vous proposer un nouveau service au diapason de cette révolution ; un service qui simplifie l'accès à ces collections généalogiques uniques et permettre d'interagir avec elles. En le rendant plus simple d'utilisation, plus moderne et ludique, ce changement radical du service a pour objectif de faire croître le cercle des passionnés de généalogie en démocratisant l'accès aux archives, notamment en permettant aux grands débutants d'accéder simplement aux données qui les concernent.
Pour autant, les habitués de Genealogie.com retrouveront toutes leurs données et les fonctionnalités qu'ils utilisaient depuis des années.
Le tout sous un logo et des couleurs plus modernes et une meilleure ergonomie. Nous savons la contrariété que peut représenter pour des utilisateurs fidèles le changement d'une interface familière. La décision a été dure à prendre et nous avons fait évoluer depuis quelques mois déjà le service afin de préparer nos utilisateurs à ce changement de leurs habitudes. Nos équipes ont énormément travaillé ces derniers mois pour permettre à tous de bénéficier de ce nouveau service dans des conditions optimales.
Une révolution dans la quête de ses origines
Grâce aux lois récemment adoptées (loi Valter, loi République Numérique), des pans entiers d'archives généalogiques deviennent plus facilement accessibles et peuvent être enrichis dans le cadre de services à destination du grand public.
Ne nous y trompons pas, ceci est une révolution.
En tant que pionnier de la réutilisation d'archives publiques en France, Filae se devait de ne pas rater cette opportunité. C'est chose faite avec le lancement, ce jour, de notre nouveau service : www.filae.com
En quelques clics, vous pouvez désormais rechercher dans l'Etat-civil français du XIXème siècle et accéder instantanément aux actes numérisés de vos ancêtres.
Plus de services gratuits
Cette refonte a également été l'occasion de simplifier l'offre, ainsi des services qui étaient jusqu'à présent réservés aux membres premium deviennent désormais accessibles à tous gratuitement :
- consultation des fiches individuelles des arbres partagés
- messagerie privée entre membres
- impressions d'arbres
- impressions de listes et de rapports
Et vous découvrirez de nouvelles fonctionnalités.
Sur Filae.com, votre passé a de l'avenir
Cette nouvelle étape dans l'histoire de la recherche généalogique sur Internet n'est qu'un début. Nous travaillons d'ores et déjà à de nouveaux enrichissements des collections généalogiques afin de vous proposer une expérience unique !
Suivez nos newsletters et notre blog pour ne pas manquer les nouveautés à venir. Nous sommes tous enthousiasmés à l'idée de partager cette nouvelle aventure avec vous. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou de vos suggestions.
Merci à celles et ceux qui utilisaient Genealogie.com depuis longtemps.
Nous avons à cœur de réussir leur transition vers Filae.com. Soyez remerciés de votre compréhension.
Bienvenue à tous les autres !
Laissez-vous embarquer dans cette formidable aventure qui va vous permettre de retrouver l'histoire de votre famille.
Vous le verrez, vos origines vont vous étonner !
Toussaint Roze, Fondateur
La consultation des données est réservée aux membres abonnés à l'Offre Premium de Filae.com. Cette petite vidéo vous explique en moins de 2 minutes pourquoi certains accès sont payants.
Les noms de lieux sont aussi anciens que les villes et villages eux-mêmes, donc ont des origines qui se mesurent souvent en millénaires ou siècles en France. Retour sur les mécanismes de choix des noms de lieux et de rues…
L'origine des noms de lieux remonte à la nuit des temps…
Les noms de lieux sont aussi anciens que les villes et villages eux-mêmes, donc ont des origines qui se mesurent souvent en millénaire ou siècles en France.
Lorsqu’une création récente s’est faite, c’est l’Etat qui décide des noms : Lorient (initialement écrit L’Orient, car ce port était celui de la Compagnie des Indes) sous Louis XIV, la ville nouvelle de Val-de-Reuil, parmi d’autres, sous Pompidou…
Mais il se crée rarement de nouvelles communes en France, les fusions sont plus fréquentes. Dans ce cas, ce sont les conseils municipaux qui tranchent ; ils se contentent souvent d’associer les deux noms (Dangé-Saint-Romain dans la Vienne par exemple) mais peuvent créer une nouvelle appellation (Genilac, une commune de la Loire, résulte ainsi de la fusion de Saint-Genis-Terrenoire et de La Cula).
Les seuls changements majeurs, mais qui vont s’effacer aussi vite qu’ils sont venus, sont ceux que la Révolution a tenté d’apporter.
En 1793, un décret invite en effet à changer les noms de lieux pouvant "rappeler la royauté, la féodalité ou la superstition". Les éléments toponymiques suspects sont remplacés : Saint-Cloud se transforme en Pont-la-Montagne, Saint-Nazaire en Port-Nazaire, Bourg-la-Reine Bourg-Égalité, etc. Une fois la Terreur passée, les anciens noms reviennent, les derniers à le faire y seront contraints en 1814.
![By Arnaud Fafournoux (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0-3.0-2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons plaque-rue](/ressources/wp-content/uploads/2016/11/Lyon_5_-_Rue_Vide-Bourse_-_Plaque_de_rue.jpg)
By Arnaud Fafournoux (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0-3.0-2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons
Les noms de rues sont plus récents et davantage modifiés
Dans les grandes villes, les rues ont parfois des noms depuis le Moyen Age. Ils avaient été donnés par les habitants et n’étaient souvent connus que de ceux qui les fréquentaient :
- des noms dûs au lieu traversé (Clos-Bruneau)
- au notable qui y habitait (rue Aubry-le-Boucher)
- au monument le plus proche (rue du Temple)
- aux artisans qui y travaillaient (rue de la Ferronnerie)
- à une particularité (rue de l’Egout)
- ou à une enseigne remarquable (rue des Jeux-Neufs)
- ...noms souvent déformés au fil des siècles.
Lorsque la ville s’étend, ce sont ses édiles qui choisissent les noms à donner aux nouvelles rues.
Aussi trouve-t-on des noms cherchant à honorer le pouvoir en place : le boulevard du Roi et le boulevard de la Reine par exemple, dans la ville nouvelle de Versailles au XVIIe siècle.
Des noms que chaque régime va modifier : la Révolution transforme les noms de rues comme elle l’a fait pour les noms de lieux (les boulevards de Versailles sont ainsi renommés boulevard de la Liberté et boulevard de l’Égalité).
Le premier puis le second Empires affichent leurs victoires militaires, la IIIe République préfère les remplacer par ses grands hommes, une volonté poursuivie au siècle suivant : les nombreux maires communistes de l’après-guerre multiplieront les places, rues et boulevards Lénine ou Staline, progressivement effacés ensuite…
Signalons que, dans les communes de toute petite taille, les noms de rues n’ont parfois été créés que peu avant l’an 2000, en général sans grand effort d’imagination (mais aussi sans polémique ultérieure), du genre Grande Rue, rue de l’Église, place de l’École...
Qui est décisionnaire ?
Les choix des noms de rues reviennent donc aux maires et aux conseils municipaux (choix qu’ils doivent faire valider obligatoirement depuis 1950 auprès de la préfecture).
Pour les petites communes, on vient de le voir, l’affaire est vite entendue.
Pour les plus grandes, depuis dix ou quinze ans, il est de bon ton de faire voter les habitants sur les choix envisagés (la ville de Rouen, par exemple, a consulté sa population avant de nommer son tout nouveau pont sur la Seine, désormais appelé pont Flaubert). Mais ce n’est pas toujours le cas et, autrefois, ce l’était rarement voire jamais.
Lorsqu’un nouveau lotissement était construit, on déclinait en général une série géographique (rue de Londres, rue d’Espagne…) ou florale (rue des Acacias, rue des Églantiers, rue des Mimosas…) qui n’allait choquer ni l’opposition ni la majorité.
De temps en temps, les choix étaient orientés par des donataires, léguant leur fortune à leur commune d’origine, à charge pour elle de donner leur nom à une rue ou une place.
Enfin, il y a des choix qui sont parfois des coups de cœur, qui équivalent à un cri enthousiaste ou partisan et ne font l’objet d’aucune consultation : une rue a été nommée Coluche à Châtellerault après le décès de l’humoriste, ainsi qu’une place à Paris ; la disparition de chanteurs reconnus comme Jacques Brel, Georges Brassens… a entraîné à chaque fois des créations ou des changements de noms de rues.
Et, dans un registre tout récent et plus dramatique, le conseil municipal de Paris vient de décider de donner à une rue le nom de Mohamed Bouazizi, le jeune homme immolé à l’origine de la révolution tunisienne.
Marie-Odile Mergnac
Michel, fils de Michel, petit-fils de Michel et père d'un Michel ? Une coutume réservée aux familles aristocratiques transmettant à chaque génération le prénom du fondateur de la dynastie quelques siècles plus tôt. Mais pas seulement...
Les prénoms lignagers des familles nobles d'autrefois
Les familles nobles pratiquaient souvent au Moyen-Age la transmission récurrente de certains prénoms. Une répétition qui rendait difficile, voire impossible, le décompte des générations et donnait ainsi l’impression qu’elles étaient d’ancienneté immémoriale, présentes depuis la nuit des temps dans leur fief.
Dans ces "généalogies immobiles", la famille se reproduisait à l’identique sur plusieurs siècles. Et la seule façon de s’y retrouver, dans les nobiliaires, était de numéroter les générations, comme pour nos rois : Raymond II, fils de Raymond I et père de Raymond III, etc.
Quels prénoms ?
Parmi ces prénoms récurrents, on trouve :
- les Guillaume chez les Tancarville,
- les Hugues chez les Lusignan,
- les Alain chez les Rohan,
- les Raymond chez les barons de Mévouillon,
- les Gautier chez les Brienne,
- les Armand chez les Polignac,
- les Archambaud chez les comtes de Périgord,
- les Amédée chez les comtes de Savoie,
- les Gaston chez les comtes de Foix,
- les Guigues chez les comtes de Forez et les comtes d’Albon,
- les Enguerrand chez les Coucy…
Parfois le "prénom lignager" change, mais toujours pour une bonne raison. Ainsi, lorsque les La Rochefoucauld de la branche aînée remplacent à la fin du XVe siècle leurs prénoms traditionnels Guy et Aymery par François, c’est parce que le roi François 1er a porté leur fils sur les fonds baptismaux. François est ensuite donné sans interruption sur neuf générations jusqu’au XVIIIe siècle.
Une tradition tout à fait universelle
Cette répétition qui nous semble surprenante était partagée jusqu’au milieu du XIXe siècle (parfois jusqu’à la Première Guerre mondiale dans les régions les plus pauvres, le Limousin par exemple) par l’ensemble du peuple.
Il ne s’agit donc pas d’une coutume réservée aux familles nobles, loin de là.
L’enfant qui naissait, quelle que soit la situation sociale et de fortune de sa famille, était inscrit par son prénom dans une parentèle précise.
La tradition fait ainsi que, pendant des siècles, le fils aîné a porté le prénom du père, la fille aînée le prénom de la mère, les suivants les prénoms des grands-parents ou des parrains et marraines.
Un casse-tête pour l'historien des familles
Chaque génération transmettait donc à l’identique ses propres prénoms à la génération suivante. Tous ceux qui ont fait un peu de généalogie le savent bien.
Qui n’a pas peiné un jour ou l’autre à distinguer les différentes branches familiales d’un patronyme fréquent ? qui ne s’est pas perdu quelque temps entre les différents Jean Martin, fils de Jean Martin et petit-fils de Jean Martin (tous laboureurs ou meuniers pour ne rien arranger) et cousins d’une brassée d’autres Jean Martin de même profession ?
Et, cerise sur le gâteau, lorsque le dit Jean Martin se remariait, il donnait à nouveau son propre prénom à l’aîné de chaque lit… Des traditions qui sont le cauchemar de tous les généalogistes d’aujourd’hui !
Une idée qui revient dans l'air du temps?
Depuis les années 1900, la mode s’est emparée des prénoms. Ils sont de plus en plus nombreux, avec une "durée de vie" de plus en plus courte.
Par exemple, les enfants de Jean et de Marie (prénoms leaders pendant quatre siècles) se nomment Michel et Monique (prénoms massivement donnés pendant quelques décennies), eux-mêmes parents de Thierry et de Martine (à la mode une dizaine d’années), à leur tour parents de Théo et Léa (qui tiendront au mieux cinq ans)…
Aujourd’hui, on veut l’originalité à tout prix. Et l’originalité, c’est parfois de prendre les modes à rebours. Un Michel a ainsi prénommé son fils Michel, et toute la famille parle en riant de « Michel I » ou « Michel II » pour s’y retrouver.
D’autres renouent avec les prénoms familiaux du passé en les redonnant aux nouveau-nés, surtout s’ils sont rares : Thélonie, Ismérie ou Iwane par exemple.
D’autres reprennent le prénom des parents ou des grands-parents. Et, puisque la fête des pères approche, quel plus beau cadeau faire à un papa que de lui annoncer que son petit-fils à naître va porter le même prénom que lui ?
Marie-Odile Mergnac
Un Thierry Riou, de Brest, rencontre un Nicolas Riou qui habite Toulouse. « Tiens, le même nom ? Serions-nous de la même famille ? Le nom doit avoir le même sens… » Pas du tout. Petit tour d’horizon de ces noms à sens multiples…
Pas de sens possible sans origine géographique connue
Pour reprendre l’exemple ci-dessus, Riou correspond en Bretagne à un ancien nom de baptême du Vannetais, Riocus, porté par un roi breton ; en langue d’oc, ce même assemblage de lettres indique une localisation d’origine : une maison près d’un ruisseau.
Il en va de même de tous les noms de famille. Il est toujours risqué d’avancer une signification tant que la région d’origine de la famille, c’est-à-dire la langue dans laquelle a été construite le nom, n’est pas connue.

Quand un sens cache l’autre…
On pourrait multiplier les exemples :
Bach : dans le Béarn, le nom a surnommé celui qui habitait au fond d’une vallée (baischa en gascon) ; dans l’Est celui qui vivait près d’un ruisseau (baki).
Bataille : dans le nord de la France, ce nom a surnommé un bagarreur, une personne belliqueuse ; dans les pays de langue d’oc, il désigne un sonneur de cloches.
Bouquet : dans le nord de la France, le nom évoque le bouc, donc les défauts de l’animal (sale, trousse-jupons…). Dans le Sud, il désigne plutôt, comme Bousquet, un lieu d’origine planté de broussailles ou de buis.
Bris : en Bretagne, le nom a surnommé une personne dont le visage était tavelé de taches de rousseur (briz en breton). Dans la région Centre, Bris correspond en revanche à une variante du prénom latin Brictius, popularisé au Ve siècle par saint Brès, successeur de saint Martin à l’évêché de Tours.
Cluze : le nom désigne dans tous les cas une localisation, mais, dans les Alpes, il s’agit d’une vallée étroite, dans le Tarn d’une grotte.
Faye : ce nom rappelle dans le Limousin que la famille vivait au départ près d’une hêtraie. Mais Faye est aussi l’un des noms les plus portés du Sénégal, y désignant un clan.
Fel : dans le nord de la France, le nom évoquait un traître, un félon. Dans la région toulousaine, il désignait une personne amère (de l’occitan fel, bile).
Margain : en Lorraine ou dans le Lyonnais, le nom vient de marga (boue), évoquant un lieu d’origine marécageux. Dans le Nord, il s’agit en revanche d’un dérivé du prénom féminin Margue, qui est lui-même un diminutif de Marguerite.
Pellé : en Bretagne, il s’agit d’un nom de hameau fréquent, donné par extension aux familles qui y vivaient. Dans le reste de la France, le nom évoque une personne chauve, au crâne « pelé ».
Queneau : en Normandie, ce nom assez répandu aurait surnommé un serviteur fidèle puisqu’il y signifiait « petit chien ». En Touraine et en Anjou, où le mot désignait un canard, il aurait été attribué à une personne boiteuse, dont la démarche rappelle celle du canard.
Attention aux rêves…
Beaucoup de personnes se mettent à rêver sur l’origine de leur nom lorsque que le même assemblage de syllabes existe dans une langue exotique. Une tendance récente, favorisée par les voyages. « N’aurais-je pas une ascendance orientale ? » demande le Berrichon dont le nom est aussi un mot de la langue yéménite ? « Mon nom signifie ‘valeureux’ en tibétain, explique un Auvergnat, je descends peut-être d’un compagnon de Marco Polo »…
Certains assemblages de syllabes peuvent se retrouver dans toutes les langues ; ils ne prouvent pas pour autant une ascendance venue de tous les pays du monde. Lorsque les noms de famille se sont créés, eux n’avaient que leurs pieds pour se déplacer. Gardons donc les nôtres sur terre…
Marie-Odile Mergnac
On peut établir, dans chaque pays, un classement des patronymes les plus fréquents. Un palmarès des noms de famille qui révèle bien des surprises si on le regarde en détail…
Le palmarès des noms de famille en France
En France, les dix noms les plus portés sont, dans l’ordre :
- Martin (porté par près de 300 000 personnes)
- Bernard
- Thomas
- Petit
- Robert
- Richard
- Durand
- Dubois
- Moreau
- Laurent
Il s’agit surtout de "prénoms" très diffusés à l’époque de la formation des noms de famille, ce qui est logique car les patronymes ont été construits :
– à partir du nom de baptême du chef de famille (7 sur 10 ici),
– de son métier (aucune occurrence ici, le nom de famille le plus porté évoquant un métier est Lefebvre (forgeron), qui n’arrive qu’en 13e position),
– d’une caractéristique physique ou morale (ici : Petit ou encore Moreau, surnommant un homme aux cheveux noirs ou à la peau sombre)
– ou de l’emplacement de la maison (Dubois).
Or les prénoms comme Martin et Bernard se donnaient du nord au sud de la France actuelle alors que toutes les autres appellations étaient construites dans une langue locale (le forgeron, par exemple, arriverait peut-être en tête si on regroupait tous les Lefebvre, Faure, Fabre, Maréchal, Schmitt, Le Goff et bien d’autres noms qui traduisent ce métier).

Va-t-on tous s'appeler Martin dans deux siècles ?
En 1973, un généalogiste, Michel Tesnière, avait publié une étude qui avait fait sensation, indiquant que, dans quelques siècles, nous nous appellerions tous Martin, Bernard, Thomas, etc. sous prétexte que "tous les corps fermés finissent pas s’éteindre" et que les noms rares disparaîtraient tous un par un au fil des mariages et d’une natalité déclinante.
Or, la proportion des Martin était de 3,8 pour mille à la fin du XIXe siècle et de 3,2 pour mille seulement en 1990.
Celle des Bernard est passée sur la même période de 2,1 à 1,6 pour mille ; etc.
L’hypothèse de 1973 était donc fausse.
D’une part parce que le risque de disparition des noms est limité. Le Pr Jacques Dupâquier, de l’Institut, a montré que ce risque était quasi nul à partir de 35 porteurs, du moins dans les populations où le taux de natalité assure le remplacement des générations, ce qui est le cas en France.
D’autre part parce que le nombre de nouveaux patronymes s’est multiplié avec l’arrivée de familles étrangères ; il y avait environ 520 000 noms de famille différents en France en 1890, mais on en comptait plus de 1 200 000 en 1990.
Des différences considérables d'un pays à l'autre
Dans les autres pays, l’importance numérique des noms de famille arrivant en tête du palmarès est très variable selon le mode de construction des patronymes.
En Italie, où les noms se sont construits, comme en France, à partir de multiples surnoms, la variété des noms reste très grande (plusieurs centaines de milliers). Rossi, le patronyme italien le plus fréquent, est porté par 420 000 personnes.
En Espagne en revanche, les noms se sont principalement bâtis à partir des prénoms. La variété est donc beaucoup plus faible (quelques milliers, pas plus) et chaque patronyme compte tant de porteurs que cela pose régulièrement des problèmes d’homonymie dans la vie courante.
Ainsi, le nom le plus fréquent d’Espagne, Garcia (issu d’un ancien nom de baptême basque), rassemble à lui seul plus de 3 millions de personnes.
Et Martin, également présent en Espagne, dépasse le million, alors qu’il est loin d’être l’un des noms les plus portés du pays ! Notre Martin français, 1er avec moins de 300 000 personnes, fait donc bien pâle figure…
Le record en Chine et au Vietnam
Si le record du nombre de noms de famille différents reste détenu par la France (à cause de la variété de surnoms et de la multiplicité des langues dans lesquels ils ont été construits – il y avait encore, rappelons-le, 620 "patois" différents parlés en France en 1800), le record du nombre de personnes portant un seul et même nom est détenu par la Chine et le Vietnam.
Pas à cause de l’importance de leur population mais à cause du mode de construction de leurs patronymes.
Car les familles ont pris pour nom, il y a mille à trois mille ans, celui de la dynastie régnante dans leur région.
Voilà pourquoi la moitié de la population du Vietnam (soit 43 millions de personnes) s’appelle N’Guyen.
Du côté de la Chine, il n’y avait au XIXe siècle que 700 noms de famille différents et les quatre plus fréquents (Chang, Chao, Li et Wang) représentent aujourd’hui à eux quatre la moitié de la population chinoise, soit 335 millions de personnes chacun en moyenne !
Certains pays ont mis en ligne des informations chiffrées sur les noms de famille, bien utiles aux généalogistes qui recherchent leurs cousins.
Bonnes recherches !